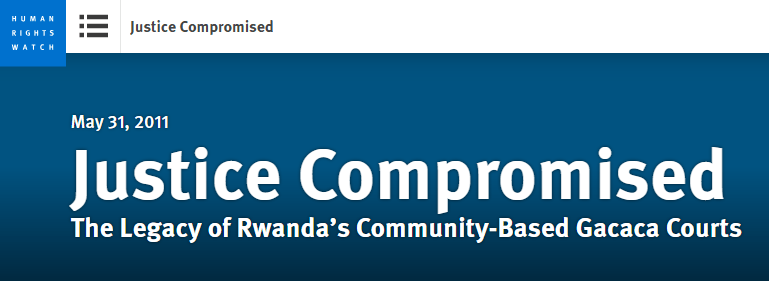Après le génocide de 1994 au Rwanda, qui provoqua la mort d’environ 500 000 tutsi de l’intérieur, le système judiciaire fut vite submergé.
Pour accélérer les procès et promouvoir la réconciliation, le gouvernement rwandais a relancé en 2001 les tribunaux gacaca traditionnels (inspirés des assemblées villageoises sur l’herbe, « gacaca » en kinyarwanda).
Les crimes furent répartis entre trois catégories :
La compétence pour les crimes de catégorie 1 comprenant notamment les faits de planification du génocide furent réservés aux juridictions classiques. Le jugement des crimes de catégorie 2 (meurtre et les blessures graves) et de catégorie 3 (crimes contre les biens, c’est-à-dire le vol, le pillage…) furent affecté aux Gacaca.
Près de 12 000 juridictions gacaca fonctionnèrent de 2005 à 2012, jugeant environ 1,9 million de cas impliquant 1,2 million d’accusés.
170 000 juges amateurs furent élus et l’obligation de témoigner fut imposée aux survivants de témoigner aux fins de favoriser la « vérité publique ».
En 2011, dans son rapport intitulé « Justice Compromised », «Justice compromise » en français, Human Right Watch tout en soulignant la productivité de ces juridictions, révélait des problèmes majeurs ainsi que des violations des droits humains, que l’on peut résumer comme il suit :
1. Manque de garanties procédurales :
– Juges non formés, souvent analphabètes, influencés par pressions locales ou gouvernementales.
– Absence d’avocats pour la défense ; accusés parfois jugés in absentia.
– Preuves basées uniquement sur témoignages oraux, sans expertise médico-légale.
2. Corruption et intimidation :
– Pots-de-vin fréquents pour alléger les peines ou faire accuser des innocents.
– Menaces contre témoins (surtout survivants) : assassinats, disparitions, harcèlement (HRW documente 40+ cas graves).
– Juges eux-mêmes victimes de violences ou corrompus.
3. Accusations politiques et règlements de comptes :
– Utilisation des gacaca pour cibler opposants au FPR (parti au pouvoir) ou régler des conflits fonciers/personnels.
– Faux témoignages motivés par jalousie, vengeance ou peur.
4. Incohérences dans les verdicts :
– Peines variables pour crimes similaires selon régions ou juges.
– Catégorie 1 (planificateurs, violeurs) réservée aux tribunaux classiques, créant une justice à deux vitesses.
HRW concluait que les Gacaca avaient « réussi à juger en masse et à libérer de la prison », mais au prix d’une « justice expéditive, partiale et parfois corrompue« .
Ainsi, le système avait « entravé la réconciliation réelle » en créant de nouvelles rancœurs et en servant de outil de contrôle politique.
Le système favorisa ainsi la version officielle du génocide tout en marginalisant les crimes du FPR.
Au-delà de ces constatation, lorsqu’on examine certains jugements rendus par les Gacaca, un schéma récurrent émerge quand les accusés sont d’anciens hauts fonctionnaires ayant exercé sous la présidence Habyarimana.
En l’absence de preuves matérielles directes, les condamnations reposent sur une chaîne d’inférences simplifiées, souvent contestables sur le plan juridique et factuel :
Parfois, une simple attestation de présence à une réunion du MRND pouvait suffire. Les juges s’efforçaient alors de démontrer que l’accusé avait participé à une réunion quelconque du MRND, parti unique jusqu’en 1991 puis majoritaire.
Cette présence était ainsi stigmatisée car considérée comme volontaire et significative, alors que tout haut fonctionnaire était de facto membre du MRND en raison de l’architecture institutionnelle de l’époque.
En effet, l’adhésion était une condition sine qua non de nomination et de maintien en poste, sans que cela implique une adhésion idéologique ou une participation active à des activités criminelles.
Une fois la participation à une ou plusieurs réunions considérée comme attesté, le jugement postulait ensuite que le MRND, en tant que structure, avait planifié le génocide.
Or cette assertion repose sur une lecture rétrospective qui confond :
– le système d’« autodéfense civile » mis en place dès 1990-1991 (initialement pour faire face à l’offensive du FPR) ;
– sa dégénérescence locale en milices Interahamwe à partir de 1993 ;
– et une prétendue décision centralisée de génocide prise au plus haut niveau du parti.
Sur la question de la planification qui ne fut jamais établie devant le TPIR (Tribunal Pénal Internation pour le Rwanda) on peut rappeler le témoignage de la principale experte témoin auprès du TPIR, Alison des Forges qui devant la juridiction d’appel du TPIR, s’exprime en ces termes :
« Tout en voyant l’existence d’un plan de façon claire, je n’ai aucune façon, aucune manière d’établir que les personnes qui ont participé à ce plan avaient l’intention de commettre un génocide et de… »
Et, en fait, je suppose même que certaines n’avaient pas cette intention.
Question : Donc, Madame, vous pensez que des personnes ont pu participer à… à cette planification du génocide de manière non intentionnelle ; est-ce que j’ai bien compris ?
Réponse : Sauf dans le sens où je ne dirais pas que ceux qui ont participé sans intention de commettre le génocide étaient des gens qui participaient à un plan génocidaire.
Parce que si l’on doit essayer de voir les caractéristiques pour la définition de ce crime, il faut qu’il y ait intention consciente de la part des participants ou des auteurs. Et donc, je ne tirerais pas ce type de conclusion, je dirais plutôt qu’il s’agissait de personnes… ou qu’il est possible qu’il se soit agi de personnes qui ont participé à la planification du programme d’autodéfense civile avant le 6 avril, et dont l’intention n’était pas nécessairement de commettre un génocide.
Parce que je n’ai aucun moyen de savoir ou de prouver qu’il y avait une intention génocidaire de la part de chacune de ces personnes. »
L’un des meilleurs spécialistes de la question, André Guichaoua, parlera même « d’impréparation butarienne » à propos des massacres commis à la préfecture de Butare.
Quoi qu’il en soit, la simple présence d’un ancien haut fonctionnaire à une réunion du MRND, génèrait un inférence automatique de culpabilité.
Cela pourrait revenir à considérer qu’après la mort de kagame, que toute personne qui aurait participé à des réunions du FPR devrait être considérée comme coupable de la planification des crimes de masse post-génocide perpétrés contre les hutu, au Rwanda, puis au Zaïre.
Encore une fois, à de multiples reprises, la simple participation à une réunion du MRND – même banale – fut érigée en preuve de «participation à la planification du génocide».
Le syllogisme était le suivant :
Double majeure : Le génocide fut planifié et le MNRD en fut le planificateur
Mineure : Monsieur K participa au moins une réunion de ce parti
Conclusion : Monsieur K fut un planificateur ou un complice de la planification du génocide.
Cette logique par syllogisme évince toute exigence de démonstration d’une intention criminelle et de lien causal direct avec les massacres.
Mais cela n’est pas tout puisque cette accusation principale, s’accompagnait le plus souvent d’une accusation accessoire d’atteinte aux biens. L’ajout très fréquent d’une condamnation accessoire pour vol et pillage, révèle selon nous la dimension prédatrice du système.
Le plus souvent, l’accusation de pillage était une anomalie manifeste en raison du profil socio-économique des accusés.
En effet, comment imaginer que des hauts fonctionnaires (préfets, directeurs de société d’État, généraux) qui appartenaient à l’élite rwandaise et disposaient souvent d’un patrimoine – terres, immeubles, comptes bancaires – conséquents, auraient pu se livrer à ce type d’agissements.
Il est à l’évidence peu crédible qu’ils se soient personnellement livrés à des pillages de biens modestes (ustensiles, vaches, tôles ondulées) au milieu du chaos de 1994, dans la mesure où les listes des « biens volés » étaient souvent constituées d’objets de faible valeur marchande (10 000 à 50 000 FRW à l’époque, soit quelques dizaines d’euros actuels).
Ces faibles montants contrastant avec la richesse présumée des accusés, l’accusation de pillage ou de vol, ne faisait guère de sens.
Alors pourquoi accompagner la condamnation principale de catégorie 1, d’un crime contre les biens de catégorie 3.
La réponse est assez simple et rejoint les conclusions de Human Right Watch : ce pattern judiciaire n’était ni plus ni moins qu’un mécanisme de spoliation déguisée.
C’est la raison pour laquelle, souvent deux volets de condamnation étaient prononcés à l’encontre des membres de l’ancienne élite.
Tout d’abord, le crime de planification du génocide, et ce, alors même que devant le TPIR jamais la planification ne fut retenue, ce crime induisant le plus souvent un emprisonnement à vie mais aucune indemnisation directe.
Les condamnations par contumace permettaient en outre de spolier les hauts fonctionnaires qui avaient fui en raison de leur connaissance du sort qui était réservé aux intellectuels hutu restés au Rwanda qui furent très souvent massacrés par le FPR.
En second lieu, le vol ou le pillage étaient retenus et se traduisaient au-delà de la peine par une condamnation à réparer par de l’argent, la restitution en nature ou en équivalent des biens prétendument pillés et souvent la saisie et vente aux enchères des biens du condamné.
Cette phase de vente en enchère s’accompagnait souvent d’une minoration de la valeur vénale des biens du condamné. Ainsi une maison à 100 000 dollars était parfois évalué à 50 000 dollars.
Les prétendus « victimes » de pillage – souvent des rescapés tutsis – étaient ainsi indemnisées sur le produit de la vente des biens saisis. Souvent, l’indemnisation ne représentait que la contrepartie des faux témoignages qui leur avaient été demandés.
Un tel système était donc une incitation structurelle au parjure. Témoigner d’un pillage fictif garantissait un gain financier immédiat, prélevé sur le patrimoine de l’accusé.
Il s’agissait par ailleurs d’un cercle vicieux que l’on peut résumer ainsi :
1. En cas d’absence de preuve matérielle de participation au génocide, une condamnation pour « planification » était obtenue au moyen d’un présomption quasiment irréfragable, à savoir la participation d’une réunion du MRND valant complicité de planification de génocide.
2. Adjonction d’un chef de pillage aux fins de financer les faux témoignages.
3. Les témoins sont rémunérés par la distribution aux prétendues « victimes » du produit de la vente des biens saisis.
C’est ainsi que cette industrie du faux témoignage put générer des confiscations massives ainsi qu’une forme de professionnalisation de la fonction de témoin.
En effet, il est attesté que dans certaines communes, les mêmes individus témoignèrent dans des dizaines de dossiers, percevant à chaque fois des indemnisations cumulées.
Aujourd’hui, le problème posé par ces jugements et ces faux témoignages n’ont pas perdu de leur actualité puisque la fabrique de faux témoignages demeurent un outils d’instrumentalisation de la justice française qui accepte beaucoup trop facilement comme argent comptant des dossiers forgés au Rwanda remis à des personnes sponsorisées par le régime pour faire valoir ces dossiers souvent crées de toutes pièces devant les tribunaux français aux fins de neutraliser des voix dissidentes.